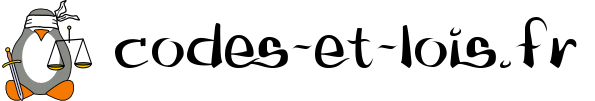Affaire AZF : de la certitude d’une relaxe à l’incertitude d’une condamnation
Le blog Dalloz - bley, 19/10/2012
 684. C’est le nombre de pages qu’il aura fallu aux juges de la cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 24 sept. 2012, n° RG 2012/642) pour livrer leur décision sur la très médiatique affaire de l’explosion de l’usine AZF. Par sa connaissance parfaite des risques liés aux produits, sa gestion dangereuse des emballages plastiques, son absence d’imposition de procédure d’exploitation et son abandon de la sous-traitance à elle-même, le directeur de l’usine AZF a commis une pluralité de fautes caractérisées exposant autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer au sens de l’article 121-3 du code pénal, permettant d’établir sa condamnation ainsi que celle de la société exploitant l’usine en sa qualité de représentant.
684. C’est le nombre de pages qu’il aura fallu aux juges de la cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 24 sept. 2012, n° RG 2012/642) pour livrer leur décision sur la très médiatique affaire de l’explosion de l’usine AZF. Par sa connaissance parfaite des risques liés aux produits, sa gestion dangereuse des emballages plastiques, son absence d’imposition de procédure d’exploitation et son abandon de la sous-traitance à elle-même, le directeur de l’usine AZF a commis une pluralité de fautes caractérisées exposant autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer au sens de l’article 121-3 du code pénal, permettant d’établir sa condamnation ainsi que celle de la société exploitant l’usine en sa qualité de représentant.
Les faits, bien que connus de tous, méritent d’être rappelés. Dans la matinée du 21 septembre 2001, l’usine d’engrais AZote et Fertilisants (AZF), exploitée par une société appartenant au groupe Total, explosait à quelques kilomètres de la ville de Toulouse, provoquant trente et un décès, plusieurs milliers de blessés ainsi que des dégâts matériels considérables. Les traces de l’explosion ont été telles – le creusement à l’épicentre de l’explosion d’un cratère de 3 000 m² et l’enregistrement d’une secousse sismique de 3,4 sur l’échelle de Richter ressentie dans un rayon de 500 kilomètres – que de nombreuses causes, à l’origine de l’explosion d’un bâtiment de stockage de l’usine, ont été envisagées avant de retenir la plus plausible, un accident chimique résultant d’un mélange entre des produits provenant d’emballages et des produits stockés sur le site. Quelques jours avant le drame, un autre bâtiment de l’usine avait, en effet, fait l’objet d’un nettoyage au cours duquel des produits chlorés avaient été ramassés à même le sol, puis versés dans une benne. Cette même benne avait été déversée, une quinzaine de minutes avant l’explosion, dans le bâtiment accueillant du nitrate d’ammonium, créant ainsi un mélange nitro-chloré qui, par réaction, a provoqué l’explosion.
Ce cocktail explosif étant notoirement connu, particulièrement dans ce genre d’usine, le directeur de celle-ci, à l’époque des faits, ainsi que la société l’exploitant ont été renvoyés devant la justice notamment pour homicides et blessures involontaires et destruction involontaire par explosion de biens appartenant à autrui.
Très peu de dirigeants participent physiquement aux opérations auxquelles sont affectés leurs employés. Aussi, dans la plupart des cas, le lien de causalité reliant leur faute au dommage se trouve très souvent n’être qu’indirect. L’espèce ne déroge pas à cette règle, la multitude de fautes reprochées au prévenu n’ayant eu que pour effet de provoquer un contexte propice à la survenance du dommage qui, ici, parle de lui-même. Cette causalité indirecte oblige ainsi l’établissement d’une faute qualifiée à l’endroit du prévenu personne physique, une simple faute ne suffisant plus depuis la loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000.
La faute, telle qu’elle est envisagée par l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, peut prendre deux formes en matière de causalité indirecte : d’une part, le cas où l’auteur, par son action, a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et, d’autre part, le cas où l’auteur, par son inaction, n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage. Ces deux cas, parfaitement cumulables (pour un ex., Crim. 13 sept. 2005, n° 04-85.736, Bull. crim. n° 224), sont précisément reprochés à l’ex-directeur. En premier lieu, celui-ci, en plus de connaître des risques liés au mélange de produits chlorés à de l’ammonitrate, s’était « totalement désintéressé du traitement des emballages et a[vait] abandonné à la sous-traitance la gestion du processus de recyclage, de stockage et d’élimination », se livrant à une gestion dangereuse des emballages plastiques (p. 364). Or, ayant connaissance « que le bâtiment recevait des emballages plastiques contenant des produits chimiques incompatibles, nitrates et dérivés chlorés, [le prévenu] aurait dû au moins élaborer et imposer des règles précises et sécurisantes d’utilisation du local et de traitement des emballages » (p. 365). En second lieu, en choisissant de confier à des entreprises sous-traitantes des missions comportement uniquement ou principalement la manipulation de produits chimiques sans « jamais les faire bénéficier de la moindre formation », le directeur avait abandonné la sous-traitance à elle-même et, dès lors, placé « non seulement [l]es salariés mais toute l’entreprise et même au-delà la population toulousaine en situation de danger permanent » (p. 378).
Cependant, pour qu’une faute qualifiée soit retenue, ces comportements ne suffisent pas, encore faut-il que le prévenu ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou, à tout le moins, ait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité. Malgré la gravité des obligations méconnues par le dirigeant, qui plus est formulées, pour la plupart, dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, les juges du fond estiment qu’une pluralité de fautes caractérisées a été commise par le dirigeant. Ces fautes pouvant être reprochées au dirigeant, la responsabilité pénale de la société exploitant l’usine pouvait dès lors être recherchée des chefs susvisés – ces infractions étaient, antérieurement à la généralisation opérée par la loi Perben II, expressément prévues par la loi.
Mais, dans la mesure où « le principe même de la responsabilité n’existe pas sans la causalité » (Y. Mayaud, Quelle certitude pour le lien de causalité dans la théorie de la responsabilité pénale ?, in Mélanges Decocq, Litec, 2004, p. 475), un enchaînement causal certain entre la faute et le dommage est exigé (V. not. Crim. 20 juin 2006, n° 05-87.147 ; 30 sept. 2008, n° 06-87.205) ; exigence à laquelle les juges de la cour d’appel ne prennent pas soin de satisfaire alors même qu’en première instance le défaut de certitude du lien de causalité était précisément à l’origine de la relaxe du directeur et de la personne morale (T. corr. Toulouse, 3e ch., 19 nov. 2009, n° 1110/09).
À la lecture de l’arrêt, on ne peut que s’interroger sur les raisons ayant conduit les juges toulousains à ne pas se prononcer sur cette exigence jurisprudentielle pourtant forte de conséquences pour l’ex-directeur, condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 45 000 € d’amende et la personne morale, condamnée quant à elle à 225 000 € d’amende. Cet évitement, couplé à l’emploi d’un vocabulaire particulièrement péjoratif – l’avocat du condamné étant allé jusqu’à qualifier l’arrêt empreint « d’une méchanceté surprenante » (Le Monde, 28 sept. 2012) – ponctuant les arguments retenus par la cour d’appel, ne sont pas sans entacher la solution d’opportunité.
Si un pourvoi en cassation a été formé par la défense contre cette décision, un éclaircissement est attendu s’agissant, d’une part, de fautes considérées comme étant la cause indirecte de la survenance du dommage et, d’autre part, de l’ajout tendancieux à la formule classique, réalisé par les juges toulousains qui considèrent que l’ancien directeur « a commis une succession de graves fautes qui ont directement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » (p. 380). Cet arrêt sort, à n’en pas douter, « de l’épure judiciaire habituelle » (Le Monde, 28 sept. 2012).
Julie Gallois
ATER à l’Université de Versailles-Saint-Quentin